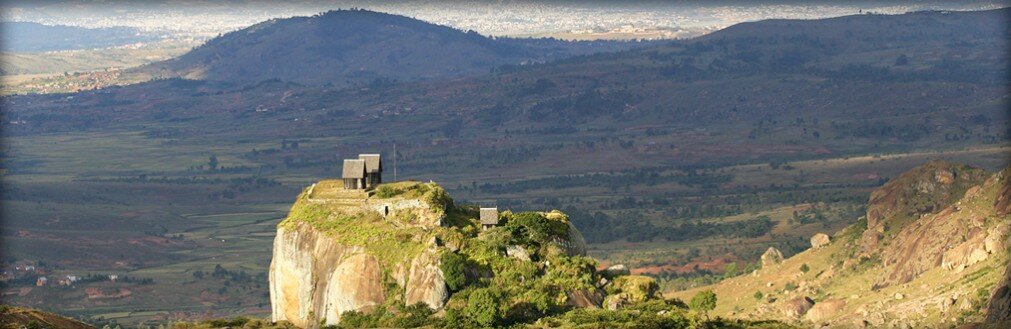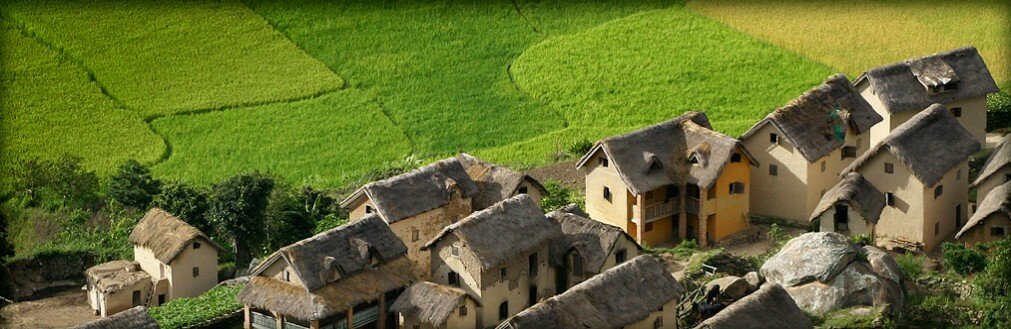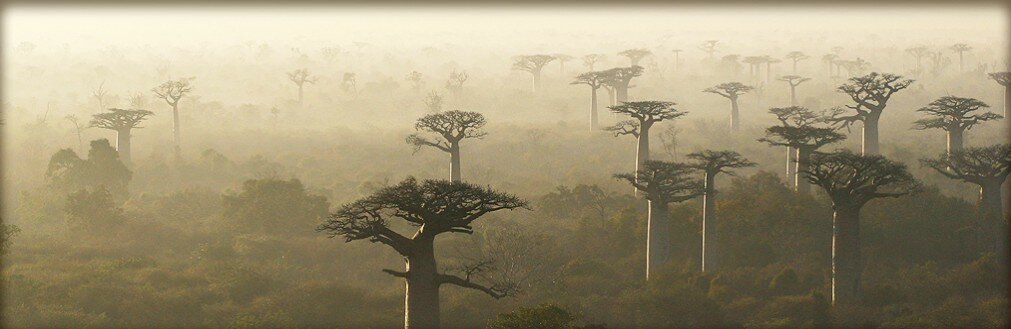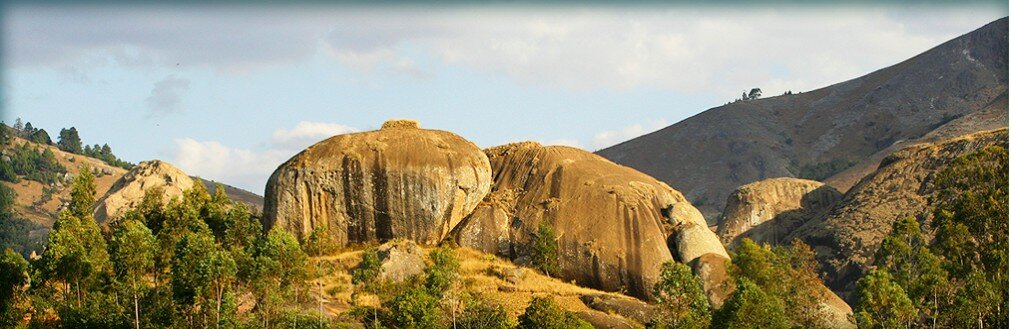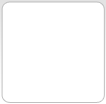Personnalités
Miretur adfatim commeatus labores deverti adfatim repente si ductante exsudatos adfatim post adfatim fiducia ductante.
- • Antoine
> 22/01/2011
• Anton
> 22/01/2011
• Lalaina Ravelomanana
> 22/01/2011
Le génie du valiha

Rajery
“Le valiha, je n’en suis que le propriétaire parmi 16 millions d’autres ”
S’il est un instrument emblématique de Madagascar, c’est bien le valiha. Longtemps assimilé aux seules mélodies nostalgiques du pays de l’Imerina, il s’est libéré de cette vision réductrice sous l’impulsion de la nouvelle génération. Rajery, ce paysan fils de paysan comme il se définit s’est déjà produit devant les publics de tous les continents, l’Australie restant le seul géant absent d’un carnet de route bien rempli. Les sons cristallins du valiha font vibrer et pénètrent les sensibilités quelles que soient les cultures. Pour Rajery, son prix RFI 2002 est avant tout une victoire de la musique malgache.

Pour certains chercheurs en mal de lignage, l’étymologie du valiha viendrait du sanskrit «adya » signifiant instrument de musique. La parenté est tentante mais Rajery reste sceptique, ses observations et échanges musicaux avec l’extérieur ayant clairement montré, du moins jusqu’à aujourd’hui, que Madagascar est bien le seul pays à posséder cet instrument. Aucune trace en Indonésie, pays de la civilisation du bambou par excellence et que l’on associe généralement aux origines des malgaches. Quant aux Malais ils ont bien le «atonga » mais cet instrument qui se joue en le frappant semble plus proche du gong chinois. Pour Rajery donc, « valiha » viendrait plus vraisemblablement du malgache «alahara » qui désigne la perfection tout en ayant une connotation sociale, le «ala » étant la limite circulaire au-delà de laquelle on refoule les exclus.
Le valiha se présente sous 3 formes, la plus connue étant la tubulaire avec 17 à 21 cordes métalliques fixées autour d’un bambou. Dans les régions arides où cette plante cylindrique ne pousse pas, le valiha prend la forme d’un parallélépipède. C’est le «aliha vata » également appelé «arovany ». Dans la région Sihanaka enfin se rencontre un valiha semi-tubulaire en tôle dont le profil rappelle celui d’une charrette couverte. Peut-on le moderniser ? Certains le font, parlant même de valiha chromatique. Rajery n’est pas contre, à condition d’en préserver l’identité.
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis sa prime jeunesse où il a appris le valiha en autodidacte. La vraie période de mûrissement a été celle allant de 1988 à 1992 durant laquelle il accompagnait le légendaire flûtiste Rakoto Frah, avant d’enfin voler de ses propres ailes. Depuis, il a toujours su concilier l’enseignement du valiha et la promotion des artistes sur le plan local avec les contraintes des tournées extérieures. On a même vu Rajery partie prenante dans un projet de musicothérapie tout en multipliant les ouvertures pour ne citer que ces occasions en or où son valiha a dialogué avec le ngoni et le kora africains, la harpe celtique ou encore le koto japonais.
Une de ses satisfactions est de constater l’intérêt grandissant suscité par le valiha auprès des étrangers, du simple touriste en quête de souvenir aux vrais pratiquants. C’est le cas de ce musicien américain, frère de la chanteuse pop K. Bush qui joue aujourd’hui du Rakotozafy à la perfection sur son «arovatana ».