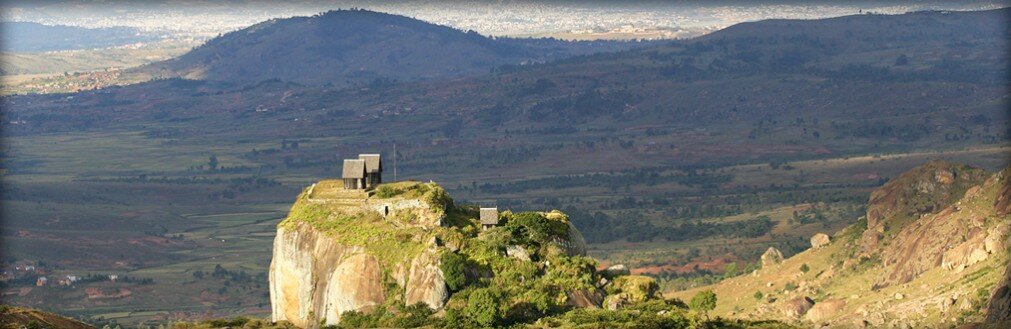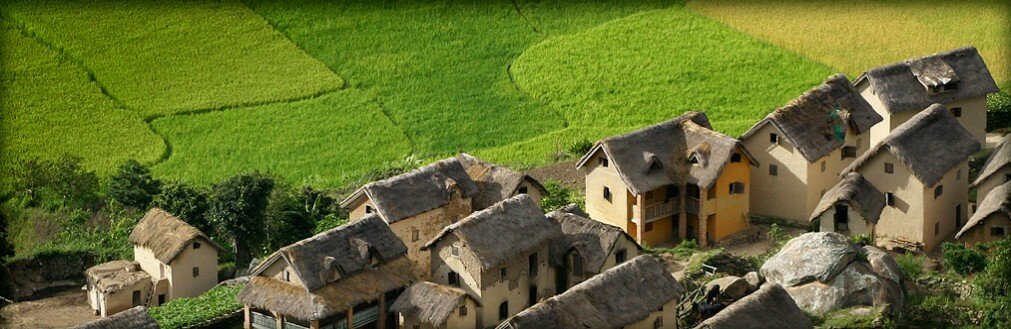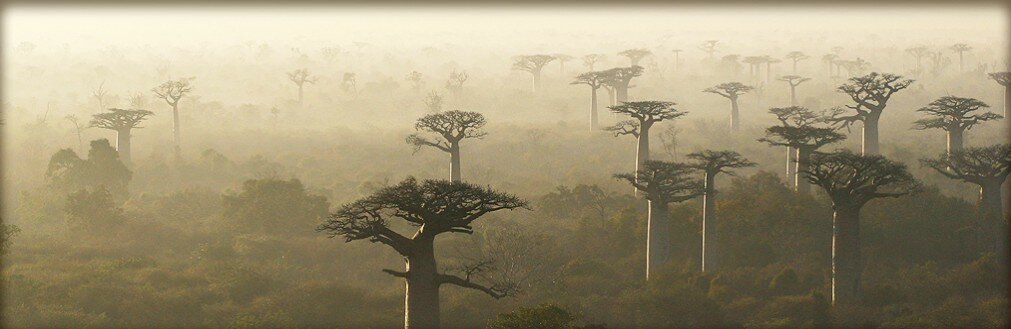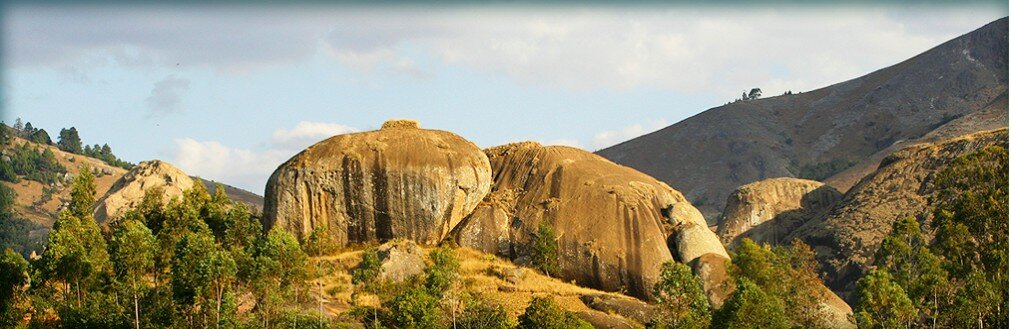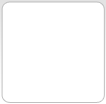Personnalités
Miretur adfatim commeatus labores deverti adfatim repente si ductante exsudatos adfatim post adfatim fiducia ductante.
- • Antoine
> 22/01/2011
• Anton
> 22/01/2011
• Lalaina Ravelomanana
> 22/01/2011
Un cœur, une plume, une langue

Rado
Véritable monument de la littérature malgache le poète-écrivain Rado a été de tous les combats chaque fois que les valeurs qu’il place au dessus de toute autre considération ont été bafouées. Egalement poète de l’amour comme il se définit lui même, c’est tout naturellement qu’il est devenu un auteur de cantiques – Dieu étant l’Amour Suprême – que hier il s’est insurgé contre l’apartheid, et qu’aujourd’hui il continue à peindre la quotidienneté des petites gens. Chantre du bonheur du couple – ce « ous né après que le « e ait fondu et que le « u se soit liquéfié – Rado l’est aussi, à l’image de la paisible retraite qu’il vit avec sa femme dans sa très belle villa entourée de « tamboho » en terre battue. Non, tous les poètes ne sont pas nécessairement maudits…
Membre à la fois de l’Académie, de l’Union des Poètes et Ecrivains, de l’Association des Mpikabary ou orateurs traditionnels, Rado ne s’est jamais voulu d’autre outil que le malgache, se fiant au génie des traducteurs pour les autres versions. C’est ainsi qu’une anthologie au titre faussement naïf de « nos deux langues » est en gestation, confiée à un cercle restreint d’universitaires et de sommités des Lettres. Une causerie avec Rado tourne souvent à un long cheminement sur le thème de cette malgachéité qui lui coule dans les veines. Il souhaiterait d’ailleurs que soit enterrée ce terme de « malgache » à relents péjoratifs car sentant à la fois le «al » et le «âchis » , et que soit réhabilitée l’appellation originelle de «malagasy».

Indifféremment le poète qu’il est réagit face à un événement extérieur ou puise son inspiration au fond de lui-même à la seule condition que soit bannie l’artifice, et c’est ce qui le différencie fondamentalement du romancier. Le stimulus exogène pourrait être comparé au galet lancé dans l’eau d’un lac et la poésie aux ondes qu’il produit. Cette poésie est dans son élément naturel avec la langue et la pensée malgaches où tout ce qui est vécu et ressenti l’est par rapport au cœur (fo) et non à l’esprit (saina), que l’on soit enthousiaste (mafana fo), abattu (mamoy fo) ou satisfait (afa-po). Et à ma question piège remettant en question la manière malgache de compter de droite à gauche en partant de l’unité, incompatible avec les machines donc avec le progrès, Rado rappelle que dans la philosophie de ce peuple on part toujours du plus petit au plus grand. C’est pourquoi le malgache parle des « enfants et des femmes » (zaza amam-behivavy) et non l’inverse, des «poules et des oies » (akoho amam-borona) ou de la «terre et du ciel » (tany aman-danitra) là où le français remue ciel et terre. Le vrai progrès ne peut venir à contre courant de certaines donnes, et Rado de parodier le discours d’un ingénieur agronome devant une assemblée de jeunes ruraux « Ni-inviter anareo tantsaha iray génération amiko aho, mba hiara-mi-examiner ity projet de développement nanaovako étude plus ou moins approfondie ity. Mi-concerner ny région-tsika mantsy izy io, ka tokony hi-sensibiliser-na ny rehetra…».
Silence gêné de la salle qui n’a rien compris, et dépit du technicien dont le message a tourné court.
Et si demain, de zébrure en dérive les malgaches finissaient par ne plus tout à fait reconnaître ni leur propre langue ni eux-mêmes ?